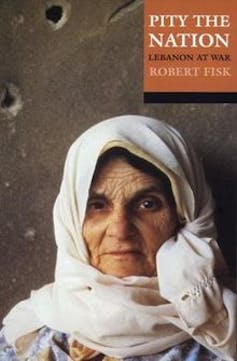- Dix ans après les « printemps arabes » : feu l’influence française ?
On se souvient d’abord d’une confusion extrême. La démission de Michèle Alliot-Marie en février 2011, à la suite de ses propos sur la situation tunisienne, trois mois après sa nomination au quai d’Orsay. La disparition de plusieurs interlocuteurs arabes encombrants mais familiers. Un processus décisionnel qui semble flotter malgré les efforts d’Alain Juppé, appelé pour redresser la machine diplomatique. La campagne libyenne de Bernard-Henri Lévy. Puis les regrets acerbes de Barack Obama pour avoir suivi la France en Libye.
2On se remémore ensuite un sentiment d’impuissance en réalité plus profond, plus ancien. L’attentat contre le Drakkar, quartier général des forces françaises à Beyrouth, en 1983, et le départ de cette France, dont les dirigeants assuraient qu’elle « n’avait pas d’ennemis ». Une Europe absente du processus israélo-palestinien supervisé par les États-Unis après 1991, et qui arrive trop tard, à Barcelone en 1995, pour accompagner une paix qui n’existe déjà plus. Les efforts français pour rester dans le jeu proche-oriental après les bombardements israéliens de Cana en 1996. Les navettes quasi mensuelles, mais vaines de Bernard Kouchner en 2007 pour tenter de trouver une issue à la crise institutionnelle libanaise, laquelle sera finalement dénouée à Doha.
3Bien sûr, il y eut des images fortes. Jacques Chirac dans la vieille ville de Jérusalem en 1996, houspillant la sécurité israélienne au plus grand bonheur des télévisions arabes. Jacques Chirac encore, quelques mois plus tôt à l’Université du Caire, appelant à une nouvelle politique arabe de la France. Jacques Chirac, toujours, recevant un accueil triomphal fin 2001 à Bab El-Oued. Jacques Chirac, surtout, s’opposant à la guerre états-unienne en Irak en 2003. Ces images ne sont pas négligeables et restent dans les mémoires. Elles rappellent que la France est là. On cherchera d’ailleurs à en créer de nouvelles : Emmanuel Macron à Beyrouth, prenant une femme libanaise dans ses bras au lendemain de l’explosion du 4 août 2020, après des mois de protestations contre un système moribond.
4Mais ces images ne changent pas la réalité profonde. La France subit une séquence difficile en Méditerranée depuis les « printemps arabes ». La région va de Charybde en Scylla. Et les temps qui s’annoncent risquent de réduire encore la marge de manœuvre.
Une séquence difficile
5Le « petit roi » Hussein de Jordanie entretenait des relations de confiance avec la France. Lors du voyage de François Mitterrand au royaume hachémite en novembre 1992, l’arrivée du Concorde présidentiel avait été filmée de longues minutes en direct, sur une télévision jordanienne fascinée par le faste majestueux de ce drôle d’oiseau français. C’est ensuite à l’hôtel Old Cataract d’Assouan, en 1995, que François Mitterrand choisit de passer son dernier Noël, sous la fidèle bienveillance d’Hosni Moubarak. Le « Docteur Chirac », lui, était régulièrement l’un des premiers acteurs informés par Yasser Arafat, au retour de ses voyages et discussions diplomatiques. Il félicitait le président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali de ses scores improbables aux élections présidentielles : 99,45 % en 1999, 94,49 % en 2004. Il était l’ami de Rafic Hariri, dont il écoutait les conseils sur la politique moyen-orientale. Hassan II du Maroc, dont il était un intime, fut, avec la Garde royale marocaine, son invité d’honneur aux cérémonies du 14 juillet 1999.
Changement d’époque
6Mais déjà, une page d’histoire se tournait. D’abord avec la disparition physique ou politique de ceux qui l’avaient écrite.
Lire la suite dans Revue internationale et stratégique 2021/1 (N° 121), pages 151 à 160