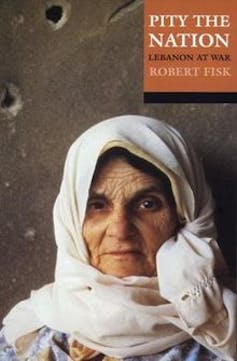Article publié dans
Global Brief (Toronto)
Ou bien les européens décident d’améliorer leur efficacité stratégique, deviennent des acteurs engagés de leur propre destin, y compris sur le plan militaire, et nous verrions alors naître une «Europe plus» – une Europe qui cesserait d’agacer outre-Atlantique par sa pusillanimité et trouverait grâce davantage aux yeux des décideurs et des analystes états-uniens, sans Trump ou même avec lui. Ou bien les Européens sortiront de l’histoire.
***
Y a-t-il alors, derrière cette attitude trumpienne, une folie négatrice de la réalité du système international actuel? Ou plutôt un néo-reaganisme en plus iconoclaste, mais avec le même mot d’ordre subliminal: «America is back»? Doit-on lire dans la cacophonie diplomatique américaine actuelle un isolationnisme véritable, qui pourrait conduire à un retrait américain tant redouté depuis 1945 – à savoir une remise en cause de la Grande Stratégie américaine en vigueur depuis la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à privilégier la capacité d’engagement militaire d’une part, le soutien à une gouvernance libérale du monde d’autre part, et la pratique du multilatéralisme enfin? Ou bien s’agit-il en réalité d’un néo-nationalisme ne mettant pas en cause le leadership américain, mais plus exigeant avec ses alliés comme pouvait l’être celui de Reagan, mâtiné d’un style volontiers grossier déjà présent sous Nixon, mais qui restait à l’époque méconnu car non relayé par les réseaux sociaux?
La réponse à ces questions est d’importance car elle déterminera l’attitude que les européens devront opposer à leur allié américain. L’Europe doit naturellement éviter d’abord le chaos pour elle-même, en ces temps de Brexit, de populisme et de divisions multiples. Les récentes élections européennes ayant montré précisément que les partis nationalistes d’une part et les partis libéraux d’autre part (possiblement alliés aux écologistes), comptaient parmi les forces montantes, appelées à s’affronter dans les prochains mois. Si cette confusion persistait, nous aurions affaire à une Europe-chaos peu intéressante pour Washington, quelle que soit l’administration au pouvoir.
Mais le temps n’est plus à décoder les intentions de la Maison-Blanche, mais à mesurer les résultats de ses choix. Le premier de ces résultats est indéniablement la double inquiétude des alliés des États-Unis vis-à-vis de la garantie de sécurité américaine d’une part, et du comportement de Donald Trump dans des régions à risque d’autre part. Néanmoins – et c’est le second point, paradoxal – cette diplomatie américaine brutale, au moins à court terme, génère parfois des évolutions positives, voire des opportunités ou des ouvertures pour l’Europe. Au final, les européens doivent retrouver les chemins de la réflexion stratégique afin de bien appréhender la nature de ce trumpisme dont rien ne dit qu’il s’arrêtera en 2020, et pour forger en retour, enfin, une vision stratégique pertinente.
Au final, les Européens doivent retrouver les chemins de la réflexion stratégique afin de bien appréhender la nature de cetrumpisme dont rien ne dit qu’il s’arrêtera en 2020, et pour forger en retour, enfin, une vision stratégique pertinente.
Les dégâts: des alliés inquiets
La présidence de Donald Trump a déjà fait mal à l’Europe – d’abord en ravivant la flamme de l’antiaméricanisme dans les démocraties libérales, de la France jusqu’à l’Allemagne. Plus généralement, les enquêtes d’opinion, comme celles du Pew Research Center, montrent une forte érosion de la confiance en l’Amérique parmi les alliés de celles-ci. En quelques semaines, l’image des États-Unis dans les opinions, qui s’était nettement améliorée sous Barack Obama par rapport aux années néoconservatrices de George W. Bush, s’est à nouveau dégradée. Le président américain a donné l’impression qu’il pouvait devenir l’ennemi – ce qui, dans l’histoire européenne, est hautement ironique compte tenu de l’engagement américain auprès des Alliés dans les deux guerres mondiales, du rôle des États-Unis dans la reconstruction de cette même Europe après 1945, et de sa protection par l’OTAN dans la Guerre froide.
Mais le style Trump a heurté, d’abord par l’image qu’il a donnée lors de la campagne électorale, et ensuite dans ses premières déclarations. Sa propension à l’insulte (vis-à-vis des femmes, des étrangers et, entre autres, d’un journaliste handicapé), si elle était faite pour conforter un certain électorat américain, a inquiété la vieille culture sociale-démocrate européenne. Et sa délectation à incarner la caricature d’une Amérique que certains aiment détester – à partir d’une image de milliardaire grossier, inculte et misogyne, soutenant la possession d’armes à feu et flirtant avec la suprématie blanche – a rendu la tâche difficile à tous ceux qui défendent la relation avec Washington.
Ensuite, Trump a touché aux garanties de sécurité américaines. En refusant de souscrire explicitement à l’article 5 du traité de l’OTAN, il a provoqué un sentiment de panique. Au malaise initial sur l’article 5 se sont ajoutées des critiques adressées aux alliés, et même des immixtions dans leurs affaires (soutenant le Brexit au Royaume-Uni, ou estimant que Boris Johnson ferait «un très bon Premier ministre»). Sa vulgarité envers Angela Merkel (refusant publiquement de lui serrer la main en mars 2017) et ses passes d’armes avec Emmanuel Macron tranchent avec le fait qu’il paraît s’entendre, du moins personnellement, avec Vladimir Poutine.
Ce dernier point tout particulièrement inquiète, aussi bien de par l’éventuel rapprochement qu’il implique avec la Russie (contre laquelle les États-Unis sont censés protéger) que pour la déstabilisation de l’exécutif à Washington. L’enquête et le rapport Mueller sur les possibles collusions russes de l’actuel président (dont les conclusions font l’objet d’interprétations variées), la nature exacte de sa relation économique, politique et personnelle avec Moscou, le nombre étonnant de décisions «trumpiennes» qui paraissent aller dans le sens des intérêts russes (surtout la fragilisation de l’OTAN, l’encouragement à un Brexit dur et le détricotage de l’Union européenne), constituent un ensemble de plus problématiques. Trump joue-t-il la carte de Moscou contre Pékin, comme Nixon avait fait l’inverse jadis? Est-il plus simplement fasciné par la personne de Poutine? Est-il tenu à une complaisance vis-à-vis du Kremlin du fait de quelques dossiers compromettants? Quelle que soit la réponse, la question elle-même est inédite à ce niveau du pouvoir américain.
Le sentiment que le locataire de la Maison-Blanche a plus d’appétence pour quelques émules ou partenaires autocratiques que pour ses alliés de longue date, qu’il est plus prompt à défendre le prince héritier saoudien à la suite de l’affaire Khashoggi qu’à soutenir les démocrates européens, qu’il est davantage intéressé par Kim Jong-un que par une discussion de fond sur l’OTAN, sont autant d’éléments d’ambiance. En envisageant l’adhésion du Brésil à l’alliance atlantique (au printemps 2019), il confirme à la fois son amateurisme politique, son mépris des affaires européennes, et son goût pour l’autoritarisme – de quoi inquiéter le Vieux continent. En jugeant l’alliance «obsolète», il fait peser le spectre d’un retrait américain, qui serait fatal à l’organisation et à la sécurité de l’Europe.
Plus encore, et même si le président n’est pas censé s’en occuper lui-même, le soutien apporté par son entourage ou ses ex-coéquipiers aux partis et mouvements nationalistes en Europe pose question. La visite européenne de son ancien conseiller Steve Bannon, à la veille des élections de mai 2019, montre que l’intention existe d’y fédérer les mouvements populistes à travers sa fondation «Le mouvement». Il y a, de toute évidence, une volonté trumpienne de susciter la progression et la victoire d’un courant «dur» dans une Europe jugée trop molle. Contre qui? C’est là toute la question. Au début de la Guerre froide, l’influence américaine en Europe était plus forte encore, mais agissait en faveur d’une démarche libérale contre le régime communiste soviétique. Désormais, le président américain favorise les acteurs illibéraux, ceux-là mêmes qui sont également choyés par Moscou. Dans les capitales qui n’ont pas succombé à la tentation populiste, on s’en inquiète forcément.
D’autant que ces pratiques d’immixtion dans les affaires nationales se conjuguent également sur le plan international, dans la parfaite logique de l’illibéralisme, lorsqu’il s’agit de s’opposer au multilatéralisme, aux traités internationaux et à tout dialogue institutionnalisé. Cette offensive est inquiétante pour l’Union européenne parce que c’est précisément sur ce terrain multilatéral que celle-ci était parvenue, notamment dans les négociations commerciales, à trouver une vitesse de croisière, tandis qu’elle reste plus maladroite dans les domaines stratégiques du hard power. La remise en cause par Trump – au mépris de l’engagement de l’État américain – des accords de la COP 21 et d’un certain nombre d’accords commerciaux, vient ruiner l’un des piliers de la tranquillité des européens, qui se sentaient en phase avec l’Amérique (avec laquelle ils avaient beaucoup travaillé) sur ces sujets.
Bref, en revenant sur des ententes forgées de concert avec leurs alliés, et en déclarant leur hostilité au principe du dialogue multilatéral dans des instances libérales, les États-Unis déstabilisent profondément l’Europe: «un monde s’effondre», pour reprendre le tweet prémonitoire de l’ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud, au soir de la victoire électorale de Donald Trump.
Les opportunités: vers la prise de conscience des européens